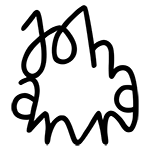Les images liquides
Texte revu et corrigé en mai 2023, initialement écrit et publié sur le site du9
« One reason why comics have not be widely studied as a form of visual culture is that the most critically successful works in the field are most often valued as literature. » [1]
Bart Beaty
J’enseigne depuis 2010 à l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême où j’ai été étudiante entre 1986 et 1991. Mon parcours professionnel peut se résumer en trois cycles de dix ans : après mes études, je deviens coloriste, je suis commissaire d’expositions sur la bande dessinée (notamment pour le compte de l’Institut Français – ex. AFAA) et je publie dans des fanzines ; à partir de 2000, je réalise neuf albums de bande dessinée (principalement pour Delcourt et Futuropolis canal-non-historique) et en fais mon activité professionnelle ; puis, à partir de 2010, je me consacre à l’enseignement, développe un travail qui croise bande dessinée et art contemporain (notamment avec le collectif In Wonder [2]) et m’inscris en thèse [3].
La bande dessinée en école d’art
Lors de mes trois premières années en tant qu’étudiante à Angoulême (1986-1989), l’apprentissage du savoir-faire scolaire de la bande dessinée [4] avec sa série de tâches à accomplir (création de personnages, scénario, crayonnés, encrage, colorisation, lettrage…), a été pour moi un calvaire et a signifié la perte de mon dessin, que j’ai mis ensuite plusieurs années à retrouver. N’étant pas très sûre de moi à l’époque (nous étions, de surcroît, seulement deux femmes dans ma promotion) il m’a fallu du temps pour m’autoriser à penser que l’apprentissage lui-même y était pour quelque chose. Peu intuitif, celui-ci peut se comparer à la danse classique : il fallait littéralement « faire des pointes », l’isograph de Rotring étant l’outil roi de l’époque. De plus, la technique de reproduction en photogravure exigeait également des rendus propres et lisibles. Les auteurs (et les rares autrices) de l’époque se définissant volontiers comme des artisans, partageant leurs outils et astuces plutôt qu’une réflexion sur le processus créatif lui-même. En outre, il ne fallait pas trop déroger des thématiques de genres, du fantastique à la science-fiction, ce qui a fait dire à Jean-Claude Mézières – lorsque je présentais à mon diplôme une adaptation de L’histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault – que je n’arriverais à rien en bande dessinée avec des sujets pareils. Autant dire que cela m’obligea à affûter mes couteaux. C’est également pour cela que je propose aujourd’hui à mes étudiant·es de choisir entre faire les entrechats et s’essayer à des expressions plus libres.
Quand y a-t-il bande dessinée ?
ILES, pour « Images Liquides : Écritures et Systèmes » est un projet de recherche-action en bande dessinée que j’ai initié à l’ÉESI en 2017, alors que j’y enseignais déjà depuis plusieurs années. L’idée était de mettre en place un projet permettant de pratiquer la recherche d’une manière qui soit compatible avec le paradigme de l’école d’art. Il fallait trouver un positionnement adéquat, tant d’un point de vue épistémologique qu’institutionnel. Tel un serpent de mer ontologique, une question récurrente en école d’art a refait surface : la bande dessinée est-elle un art appliqué, une forme littéraire, un médium ou encore autre chose ? Embusquée derrière cette question s’en tenait une deuxième : peut-on considérer (et donc enseigner, étudier, pratiquer une recherche sur) la bande dessinée comme art ? Question problématique, car définir l’art n’est pas plus aisé que de définir la bande dessinée. « La littérature esthétique est jonchée de tentatives désespérées pour répondre à la question : ‘Qu’est-ce que l’art ?’ » écrit Nelson Goodman dans un essai désormais célèbre [5]. De surcroît, il peut y avoir confusion sur le mot lui-même : l’art (sous-entendu la grande famille des arts plastiques et visuels) signifie autre chose que l’art de (autrement dit les qualités relatives à un savoir-faire) employé le plus souvent pour parler de la bande dessinée dans sa spécificité de neuvième art.
Pour Nelson Goodman, la question relative à l’essence de l’art se confond avec : qu’est-ce que le bon art ? Alors que nous devrions plutôt nous demander : quand y a-t-il art ? La force symbolique des diplômes comme le DNA ou le DNSEP mention bande dessinée de l’ÉESI [6] milite en faveur d’une reconnaissance de la bande dessinée comme un « fait de l’art » dans son acception pleine et entière. Pour Goodman, ce qui légitime symboliquement une chose comme art s’applique non seulement au contexte, mais également aux qualités intrinsèques d’une œuvre : « (…) le dessin d’un seul trait d’une montagne par Hokusai où chaque trait de forme, de ligne, d’épaisseur, etc., compte », ne peut être confondu avec « des moyennes quotidiennes de la Bourse », malgré leur forme proche [7]. Dans le cas qui nous intéresse, je dirais que seuls certains éditeurs confondent bande dessinée et cours de la Bourse ! La énième question à se poser serait donce: quand y a-t-il bande dessinée ?
Dans le manifeste écrit en 2015 pour les éditions Adverse, Alexandre Balcaen parle de territoire des possibles et questionne le terme de bande dessinée qu’il juge trop restrictif : « Outre les problèmes que peuvent soulever le terme lui-même et son postulat excluant (quand ce n’est pas en bande, que ce n’est pas dessiné ?), il nous importe surtout de questionner la nécessité du récit. Une nécessité non seulement supposée, mais revendiquée — ainsi qu’en témoigne la prolifération de nouvelles dénominations telles que roman graphique, narration graphique, littérature graphique — qui évacuent de facto certaines formes les plus recherchées et les plus poétiques de l’art qui nous occupe. » Alexandre Balcaen propose même de remplacer le terme de bande dessinée par celui de tableau fragmenté, rappelant la notion de tableau déconstruit [8] de Pierre Fresnault-Deruelle. Ces deux termes renvoient à l’idée de surface, de cadre englobant plusieurs éléments d’une scène ou d’un ensemble, et tentent précisément de cerner ce qui fait « bande dessinée ». Ils mettent l’accent sur la filiation entre la peinture et la bande dessinée, ainsi que sur les qualités fragmentaires, malléables et adaptables des images qui la constitue.
La bande dessinée comme art visuel
Au final, le choix de placer le projet de recherche ILES dans le champ des arts visuels s’est rapidement imposé comme le plus pertinent. J’utilise d’ailleurs volontiers le pluriel pour souligner la multiplicité des bandes dessinées et des œuvres qui peuvent être considérées comme telles [9]. En cherchant à qualifier le régime spécifique des images de bande dessinée, l’idée n’était plus de trouver une (nouvelle) définition, mais de voir comment il était possible de développer un nouveau discours sur elles. Comment rendre compte de cette propriété qui permet de décomposer ou réinterpréter le « tableau » sans le détruire ? Comment nommer un régime capable de générer un récit à partir d’éléments variés, voire hétéroclites, aux propriétés ouvertes -au sens où l’entendait Umberto Eco- grâce à la flexibilité de leur structure [10] ? La notion de liquidité est apparue au détour d’une conversation : pourquoi l’adjectif s’appliquerait-il aux textes liquides du web plutôt qu’aux images composites qui s’agencent en strips, en planches ou dans une séquence de turbo-média ? La liquidité serait aux images de bande dessinée ce que le mouvement ou le temps sont aux images de cinéma chez Gilles Deleuze [11] : à la fois un état et un processus. Si la notion de liquidité pouvait faire penser au concept de modernité liquide [12] théorisé par le sociologue Zygmunt Bauman, cela n’a cependant pas été un obstacle : il était même assez intéressant d’assumer l’idée que les bandes dessinées pouvaient être des objets post-modernes avant l’heure ! La notion d’images liquides est ainsi devenue un outil conceptuel que nous avons mis à l’épreuve de nos réflexions au sein du projet ILES.
Comment les images peuvent-elles être liquides ? De prime abord, cette proposition semble contre-intuitive, particulièrement dans le cas des images fixes. L’ellipse en bande dessinée a été largement théorisée : dans l’espace vide se déroule le film mental de le·a lecteurice et les associations laissées à son interprétation. Mais parler des effets de rupture ou de suspens, c’est parler du vide plutôt que du plein, de la structure plutôt que de la substance. Ce qui fait dire à Michel Matly : « Le choix structural de se situer hors du contenu et du style, laissé à l’appréciation des auteurs et à l’arbitraire des œuvres, pousse la recherche théorique (en bande dessinée) à pratiquer la politique de la case vide [13] ». Du propre aveu de Thierry Groensteen, l’approche néo-sémiotique [14] ne permet pas de s’intéresser à ce qui se passe à l’intérieur des cases, aux qualités plastiques des œuvres. Son approche systémique vise plutôt le fonctionnement d’éléments de mise en page et mise en planches ou en strips, comme le multicadre, dans lesquels se glisse un contenu (textes et images), contenu auquel ils donnent sinon un sens, au moins une logique de lecture.
Poursuivant la métaphore sur les degrés de viscosité qu’une bande dessinée pourrait atteindre, l’état solide serait celui d’une œuvre achevée, définitivement exécutée, puis imprimée ou mise en ligne, publiée et diffusée. Dans sa forme hiératique, imprimée sur papier, la planche confère à la bande dessinée l’apparence d’une langue morte qui s’anime et parle au regard, à condition, bien sûr que l’on sache la déchiffrer [15]. L’état solide de la planche prêterait ses éléments structurels à l’analyse, tandis que l’expérience de sa lecture [16] la ferait retourner à un état liquide, nous permettant de plonger dans une histoire, une expérience visuelle pure [17] dont la tonalité serait tourbillonnante, stagnante, débordante ou portée par un léger clapotis. Dans L’Eau et les Rêves, Gaston Bachelard médite sur les liens que l’élément aquatique tisse avec notre imaginaire : « (…) la liquidité est, d’après nous, le désir même du langage. Le langage veut couler. Il coule naturellement [18] ». L’expérience esthétique en bande dessinée serait ainsi produite par l’écoulement des images, dont la liquidité serait la condition. Comme on l’a déjà vu, approcher la forme par la sémiologie, c’est passer le plus souvent de la structure à l’idée, du signe à son sens, comme si l’on pouvait enjamber la matière sans que cela ait de conséquence.
Culture visuelle versus images mentales
Dans la thèse que j’ai commencée en octobre 2018 et qui porte sur le récit (autobiographique) des rêves en bande dessinée, la question de la figuration (et non de la figurabilité) est centrale. Cette question a donné lieu à une littérature psychanalytique abondante. Mais si l’herméneutique freudienne peut s’avérer pertinente dans le cadre de la cure, elle me semble peu opérante pour parler des nocturnaux graphiques qui, à quelques exceptions près, n’ont aucune velléité thérapeutique. Je dirais même que ce qui prime pour les auteurices dans ce type de travail, c’est ce que Freud appelle le contenu manifeste (l’image, sa forme, sa localisation dans un flux d’images, ses itérations) plutôt que le sens latent. Les questions soulevées sont donc celles du passage des images mentales au dessin, du choix de garder certains contenus plutôt que d’autres et de ce que l’on pourrait appeler une force ou un impact visuel.
Selon le chercheur canadien Bart Beaty, les approches analytiques basées sur les rapports texte-image ou empruntées aux études littéraires (analyse des contenus, des types de récits, de styles ou de genres) passent trop souvent à côté de la dimension purement visuelle, pourtant centrale dans la compréhension des bandes dessinées [19]. Si la culture visuelle contemporaine est nourrie par des bandes dessinées emblématiques, ces dernières puisent dans des registres d’images présents ou passés. À ce titre, la bande dessinée est un art d’emprunts, d’imprégnations et de recyclages. L’expérience du rêve reposant principalement sur des images remémorées ou recréées à partir d’expériences vécues, la culture visuelle individuelle se voit ainsi mobilisée dans l’expérience du rêve, comme en témoignent les rêves « de dessins » [20]. Pratiquant moi-même le nocturnal graphique depuis mon adolescence, je perçois les œuvres de mes confrères et consœurs du double point de vue de l’autrice et de la lectrice. Ces œuvres m’emmènent dans des réflexions que des théoricien·nes se basant sur l’œuvre achevée (éventuellement accompagnée d’étapes préparatoires) n’auront pas forcément.
On en revient à la question de la liquidité des images, à cet outil conceptuel imaginé pour accompagner un programme de recherche, dédié aux créateurices qui souhaitent faire émerger de nouveaux discours théoriques. La recherche création est à ce titre féconde : elle oblige le·a chercheureuse à faire une double vérification des hypothèses générales à l’aune de leur pratique. Dans le cas de mon sujet, parler de vases communicants entre la culture visuelle et les images mentales ne sera pas une simple formule : si l’on y intègre la notion de liquidité propre au régime d’images de bande dessinée, on se rend compte à quel point la pratique de la bande dessinée forme et informe nos processus cognitifs dans leur ensemble.
********
[1] « L’une des raisons qui explique pourquoi la bande dessinée n’a pas été largement étudiée comme une forme d’art visuel, viens du fait que les œuvres ayant reçu le plus grand succès critique l’ont été en tant que littérature. » Bart Beaty, Comics versus Art, Toronto University Press, 2012.
[2] In Wonder est un collectif constitué de quatre artistes-auteurices : Emmanuelle Espinasse, Henri Lemahieu, Régis Pinault et Johanna Schipper. www.in-wonder.com
[3] À l’université Bordeaux Montaigne (laboratoire ARTES) sous la direction de Pierre Sauvanet.
[4] L’ouvrage de référence pour apprendre la bande dessinée dans les années 1980 était le manuel en trois tomes de Bernard Duc : L’Art de la BD aux éditions Glénat.
[5] Nelson Goodman, Quand y a-t-il de l’art ? dans Esthétique et Poétique, page 79, éditions du Seuil, 1992.
[6] Depuis 2011, le Diplôme National d’Art et le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique mention bande dessinée, sont des diplômes supérieurs en art où il est possible de présenter exclusivement des bandes dessinées.
[7] Nelson Goodman, ibidem, page 79.
[8] Pierre Fresnault-Deruelle, L’Éloquence des images, Images fixes III, chapitre 17, P.U.F. coll. « Sociologie aujourd’hui », 1993.
[9] Ce qui caractérise la vivacité d’un champ, au sens où l’entendait Pierre Bourdieu, c’est la diversité des différents courants qui le compose.
[10] Maaheen Ahmed, Openness of Comics : Generating Meaning Withing Flexible Structures, University Press of Mississippi, 2016.
[11] Gilles Deleuze, Cinéma 1 : l’image-mouvement et Cinéma 2 : l’image-temps, éditions de Minuit, 1983 & 1885.
[12] Michel Matly, « Bande dessinée et transmission du sens », Comicalités, Histoire et bande dessinée : territoires et récits, 2015, [En ligne] : http://journals.openedition.org/comicalites/2065
[13] Cette notion s’est développée dans l’œuvre de Zygmunt Bauman pour caractériser l’incertitude et l’instabilité qui caractérise les sociétés postmodernes.
[14] « Le dessins est trop souvent l’impensé de la critique, c’est vrai, et il l’est tout autant de la théorie, qui, étant d’inspiration sémiotique, s’intéresse traditionnellement surtout aux effets de séquentialité ou de tabularité (…) » Thierry Groensteen dans 100 cases de Maîtres : un art graphique, la bande dessinée, sous la direction de Gilles Ciment et Thierry Groensteen, page11, éditions de La Martinière, 2010.
[15] Ma mère, née en 1936, disait avoir du mal à lire les bandes dessinées, ne sachant s’il fallait commencer par regarder les images ou lire les textes.
[16] La chercheuse Laura Caraballo propose le néologisme de visio-lecture pour parler d’un mode de lecture propre aux bandes dessinées.
[17] Absence de récit ne veut pas dire absence d’expérience esthétique, comme le fait remarquer Alexandre Balcaen.
[18] Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, page 210, librairie José Corti, 1942.
[19] Bart Beaty, Comics versus Art, Toronto University Press, 2012.
[20] Notamment chez Jean-Christophe Menu dans « S.O.S. valises », Pandora N°3, 2017